|
Mardi 28 août
La poussière, âcre, rentre par tous les joints du camion, s’insinue
partout, jusque dans nos poches, s’incruste dans les narines et sèche
nos gorges assoiffées. Depuis trois jours, nous sommes entassés
à sept dans l’ancienne ambulance russe et, sans le talent de notre
chauffeur Onour, notre véhicule ne serait qu’une épave de plus
au bord de la piste.
Depuis trois jours, l’immense plaine des fils de Temudjin est notre royaume.
Oulan-Bator n’est plus qu’un lointain mirage, et la civilisation, un lointain
souvenir. Je regarde Bernard et son mètre quatre-vingt-dix, plié
sur la banquette, dans le sens inverse à la marche, essayer de ne pas
se briser le crâne contre les parois du camion. A mes côtés,
Tulga, notre guide, m’interpelle, un sourire aux lèvres :
- Alors Philippe, enfin chez moi, sur la terre de mon peuple !
- Oui Tulga, ton pays, un immense mystère pour nous, et nous comptons
sur toi pour faire sa connaissance.
Tous approuvent, dans un brouhaha général, entre les secousses,
au milieu des sacs caméras et des provisions.
Trois jours
plus tôt. Submergés par les bagages, Pierre-Marie, Bernard
et moi-même, nous interrogeons du regard, avec une moue d’inquiétude,
dans l’aéroport d’Ulaan- Bator. Une nouvelle tête fait partie
du groupe Nature Eau Scope. Dominique Beck, lyonnais, et surtout grand plongeur,
nous accompagne douze jours. Calme, tranquille, l’agitation environnante ne
semble pas le toucher outre mesure. Il me regarde, sourit, et, sans échanger
une parole, j’ai compris, il en a vu d’autres. Une chance, car Nature Eau
Scope, par définition, sur le terrain, c’est plutôt sportif !
Bernard continue à récupérer sacs, bagages divers, caméras,
bouteilles pour la plongée, compresseur, qu’il entasse à mes
pieds. Pierre-Marie sort du bâtiment. Normalement, nous sommes attendus.
Sinon, il va y avoir un problème. Mais Gamba, petit, brun, un sourire
jusqu’aux oreilles n’a pas failli. Depuis six mois, avec Tulga, ils préparent
sur le terrain, cette grosse expédition. Location du véhicule
avec son chauffeur, l’essence, les provisions, les chevaux pour la partie
randonnée au lac Khövsgöl, le canot pour la descente de
la rivière Egin Gol, tout cela est sous leur responsabilité.
C’est l’aïmak central, l’aïmak de Tov, qui abrite Ulaan-Bator.
L’aïmak de Tov est une des dix-huit provinces qui composent cette jeune
république. Deux millions et demi d’habitants, la moitié de
ceux-ci urbanisés et l’autre moitié qui nomadise sur un territoire
grand comme trois fois la France. Un territoire sans frontières, sans
barrières. Mais aussi un pays où tout est à faire, où
tout est à construire. Même une route reliant l’ouest et l’est
du pays semble un insurmontable défi. Comment financer pareille entreprise
? Rien qu’une route, ce sont des millions de dollars à trouver. Et
pas auprès de la population, dont la moitié voyage au grès
des saisons en totale autarcie. En attendant, ses dirigeants sourient à
l’encombrant voisin du nord, la Russie, et parle poliment à son immense
voisin du sud, la Chine.
Difficile à imaginer alors que sous l’autorité de Temudjin,
devenu Gengis Khan en 1206, l’empire mongol s’étendait du fleuve
jaune au Danube, et de la Sibérie au golfe Persique. Deux fois plus
grand que l’empire romain à son apogée ! Il faut savoir également
que le mot "mongol", regroupe sous cette appellation les innombrables tribus
qui ont accepté de gré ou de force, de se regrouper sous la
bannière de Gengis Khan… Les autres ont été exterminées.
Ulaan-Bator, capitale où cohabitent immeubles et yourtes, 4x4 rutilants,
camions à l’agonie, avec probablement plusieurs fois le tour de la
terre dans les roues, charrettes à chevaux. C’est l’Asie ; le code
de la route est ... approximatif, les changements de direction ... impromptus,
et les piétons des cibles potentiels. Ulaan-Bator compte aujourd’hui
environ 650 000 habitants, dans une ville où l’empreinte architecturale
socialiste est évidente. Grandes artères rectilignes, grandes
barres d’immeubles austères et tristes.
Nous zigzaguons au milieu de la circulation, tentant d’éviter l’accrochage,
les nids de poule qui ressemblent étrangement à des trous
de bombes ! Aujourd’hui mardi 28 août, 18 heures, nous finissons de
charger les pommes de terre, le riz, les conserves, les allumettes, les saucissons
qui vont lentement sécher pendus dans le camion, et, les sacro-saintes
bouteilles de vodka, qui "doivent " servir à la fois de présents,
de lien de conversation et de passeport. Sur le toit, les huit bidons d’essence,
les tentes… le tout recouvert d’une bâche et soigneusement ficelé,
les chaos de la piste valant largement ceux du Paris-Dakar. L’avantage est
que le chronomètre nous est inconnu, nous n’avons personne sur le dos
et voyageons seuls, en toute liberté, un bien-être inestimable
.Il ne saurait en être autrement, notre programme, chargé, ne
pouvant subir aucune autre contrainte que les nôtres.. Il fait jour
encore, lorsque nous quittons Ulaan-Bator, pour un mois de voyage. Nos espoirs
se tournent en premier vers la météo. Fin août ici, il
peut neiger. Nous sommes sur un plateau, à environ 1500 mètres
d’altitude, tout est possible. Pour l’instant, l’air est limpide, un souffle
d’air d’une exceptionnelle douceur nous enveloppe, les collines ondulent à
perte de vue, et c’est un immense bonheur de fouler ce sol dont nous avons
rêvé si longtemps, qui a demandé tant de travail, tant
d’énergie Nous cahotons à soixante kilomètres-heure,
sur la route principale qui appelle une réflexion :
-Tulga, dis-moi, cette route, c’est vraiment la route principale ? Quand
doit-elle être réparée ?
- Tulga, sérieux, voir gêné : Mais, elle a été
réparée l’année dernière ! Elle est donc aujourd’hui
en très bon état.
A quoi donc ressemble alors la piste ? Je pars déjà avec
un mal de dos, je crains de rentrer avec les vertèbres ruinées.
23 heures, la nuit est tombée sur la steppe A la lueur des phares,
le camion a quitté la piste et s’est arrêté, on ne sait
où ; peu importe. Nous descendons du camion, entourés d’un silence
impressionnant, après le vrombissement du moteur. Nous osons à
peine troubler la magie de ce moment plein de grâce. La tête dans
les étoiles, les trois tentes sont montées rapidement ; Onour
avec Gamba, Tulga et Dominique, Pierre-Marie, Bernard et moi dans la troisième
tente ; celle que nous connaissons si bien, la tente du Spitzberg. Un repas
froid est avalé rapidement. Puis Gamba trouve l’instant de ce premier
bivouac propice à une offrande. Une offrande aux dieux, bien sûr,
et la bouteille de vodka surgit subitement entre ses mains. La première,
d’une longue série de bouteilles est ouverte, mais il ne faut le dire
à personne ! La bouteille fait le tour du groupe ; chacun trempe l’extrémité
d’un doigt dans le liquide, puis à l’aide du pouce, une goutte est
projetée au ciel, à la terre… et le reste est bu consciencieusement.
Quelques minutes plus tard, allongé dans le duvet, je pense aux huit
cent kilomètres qui nous séparent du lac Khövsgöl.
Le 8 septembre, toutes les plongées devront être faites. Toutes
les images sous-marines tournées. Parce que le 8 septembre, Dominique
repart pour Lyon et nous devrons continuer à trois comme nous l’avons
déjà fait, mais les séparations, dans ces moments là,
sont toujours un peu difficiles, à la hauteur des moments partagés.
Pour l’instant le ciel et la terre sont à nous. Et les poissons ?
Peut-être !
Mercredi 29 août.
J’émerge lentement vers sept heures. Pierre-Marie et Bernard
sont déjà dehors ; il en sera ainsi pendant tout le voyage.
Je sors la tête de la tente. Le temps est parfaitement clair. Je salue
tout le monde, Tulga aux gamelles, Gamba et Onour s’affairent de leur côté,
et la caméra tourne. Le soleil dépasse lentement le sommet
de la colline située à quelques kilomètres. Au pied
de la colline, quelques yourtes s’éveillent également. La fumée
sort des tuyaux des poêles, et monte, rectiligne vers un ciel d’un bleu
étourdissant. Il fait déjà quinze degrés. Le
petit déjeuner, à base de pain et viande n’est pas du goût
de tout le monde. Mais, qu’y faire ? L’avenir nous réservera bien d’autres
surprises culinaires !
Le camion rechargé, nous reprenons la piste vers l’ouest. Cette
piste, c’est un véritable appel à l’aventure, un pari vers
l’ailleurs… et l’autre . L’autre, que nous regardons comme un étranger,
et dont nous avons tant à apprendre. L’autre, l’homme qui est devant
nous, dont les priorités sont à cent lieues de nos mesquines
petites misères quotidiennes ; pour qui chaque jour est une lutte
pour la survie, et qui nous renvoie brutalement au visage, notre confort,
tellement anesthésiant que l’on ne s’en rend même plus compte.
Envoûtés par ce ruban de poussière défoncé,
sur lequel nous ne savons de quoi sera faite la seconde qui vient, nous continuons
la piste plein ouest. De chaque côté, des yourtes, ou plutôt des gers,
puisque c’est la dénomination mongole qui convient ici ; le mot yourte
lui, est russe. Les Mongols s’installent souvent en famille : les parents,
les enfants, les grands-parents, le schéma le plus fréquent,
ce sont deux à cinq tentes, avec autour les troupeaux de moutons,
chèvres, yacks ou chevaux selon l’option choisie. Puis, selon le niveau
de vie, une charrette tirée par les yacks, une carriole aux roues
plus ou moins rondes, un tracteur parfois, ou un 4x4 pour les plus riches.
Et pour ces derniers, beaucoup, beaucoup de travail. Les juments, par exemple,
pour les plus grands troupeaux, doivent être traites toutes les deux
heures. Cela signifie que, la traite est terminée, il faut immanquablement
recommencer au début. Le lait est pour une partie, bu frais ; mais
les conditions de conservations, inexistantes, font qu’il faut le transformer
rapidement. Une partie est mise à chauffer sur le poêle de la
ger, puis après avoir été longuement remué avec
une louche, il reste au repos la nuit, pendant que se forme une épaisse
couche de crème. Cette crème, c’est une crème dessert
, ou un fromage frais servi sur des tranches de pain. D’autres fromages sont
également fabriqués, qui selon le degré de maturation,
vont de frais à piquant, et ainsi jusqu’à "l’excellent" fromage
caillou, resté à sécher des jours et des jours sur le
toit de la ger. Celui-ci, inutile de vouloir le croquer, sauf à risquer
d’y laisser sa dentition, car il n’a pas usurpé son nom. Alors, cassé
en petits morceaux, vous le sucez lentement, comme un bonbon, mais un bonbon
pour le moins acidulé, au goût de lait caillé. Une application
supplémentaire transforme le lait en vodka mongole, un liquide transparent
comme l’eau, au goût aigre, très prisé et malheureusement
beaucoup offert aux voyageurs que nous sommes !
De chaque côté, des yourtes, ou plutôt des gers,
puisque c’est la dénomination mongole qui convient ici ; le mot yourte
lui, est russe. Les Mongols s’installent souvent en famille : les parents,
les enfants, les grands-parents, le schéma le plus fréquent,
ce sont deux à cinq tentes, avec autour les troupeaux de moutons,
chèvres, yacks ou chevaux selon l’option choisie. Puis, selon le niveau
de vie, une charrette tirée par les yacks, une carriole aux roues
plus ou moins rondes, un tracteur parfois, ou un 4x4 pour les plus riches.
Et pour ces derniers, beaucoup, beaucoup de travail. Les juments, par exemple,
pour les plus grands troupeaux, doivent être traites toutes les deux
heures. Cela signifie que, la traite est terminée, il faut immanquablement
recommencer au début. Le lait est pour une partie, bu frais ; mais
les conditions de conservations, inexistantes, font qu’il faut le transformer
rapidement. Une partie est mise à chauffer sur le poêle de la
ger, puis après avoir été longuement remué avec
une louche, il reste au repos la nuit, pendant que se forme une épaisse
couche de crème. Cette crème, c’est une crème dessert
, ou un fromage frais servi sur des tranches de pain. D’autres fromages sont
également fabriqués, qui selon le degré de maturation,
vont de frais à piquant, et ainsi jusqu’à "l’excellent" fromage
caillou, resté à sécher des jours et des jours sur le
toit de la ger. Celui-ci, inutile de vouloir le croquer, sauf à risquer
d’y laisser sa dentition, car il n’a pas usurpé son nom. Alors, cassé
en petits morceaux, vous le sucez lentement, comme un bonbon, mais un bonbon
pour le moins acidulé, au goût de lait caillé. Une application
supplémentaire transforme le lait en vodka mongole, un liquide transparent
comme l’eau, au goût aigre, très prisé et malheureusement
beaucoup offert aux voyageurs que nous sommes !
Ici, la mécanique se doit d’être une seconde nature. Nous
nous demandons si le parc automobile en panne, n’est pas plus important
que le parc roulant. Il ne se passe pas vingt minutes sans que l’on trouve
un camion arrêté sur le bord de la piste, une voiture sur cales,
des gens penchés sous le capot, couchés sous le véhicule.
Alors, la durée de l’immobilisation n’étant pas connue, les
familles déchargent le véhicule, installent un campement,
et attendent, un certain temps, un temps souvent lié aux compétences
du chauffeur. Evidemment, téléphoner à son garagiste
et attendre une dépanneuse est une vision purement européenne.
Nous en faisons l’expérience vers onze heures quand le camion s’arrête.
Nous descendons tous nous dégourdir les jambes pendant que Onour sort
la caisse à outils. Caisse plutôt symbolique car nous n’y trouvons
qu’une demi douzaine de clés plates, une pince et deux tournevis,
guère plus. Et pourtant, c’est avec ce peu de matériel que
Onour accomplira, plus tard, un miracle. Pour l’instant, il s’agit uniquement
de la pompe à essence, ce qui semble une simple formalité,
et un problème résolu entièrement avec le sourire. Vers
onze heures trente, nouvel arrêt. Nouvelle panne. Pierre-Marie sort
la caméra, car tout autour de nous, les aigrettes nous offrent leurs
graciles silhouettes, un reptile attire également notre œil. Un peu
plus loin, une nouvelle panne alors qu’un jeune mongol en del, le vêtement
national, longue tunique épaisse en laine, laisse paître quelques
chameaux. Nous remplaçons les banquettes du camion, par la selle moelleuse
du chameau contre un petit cadeau.
Nous stoppons vers quatorze heures trente près d’un ruisseau.
Tous en short, car il fait très chaud. Tulga allume un feu sous la
gamelle avec l’argal, la bouse séchée. Comment voulez-vous faire
autrement ? pas un arbre, une branche, une brindille. Alors l’argal, ramassé
avec soin pendant l’été et séché représente
un carburant fort convenable, voir indispensable, car ici, l’hiver est long
; ce carburant qui alimente sans discontinuer le poêle au milieu de
la ger, permet d’entretenir une température intérieure d’environ
20 degrés, alors qu’à l’extérieur règne un froid
intense et redoutable. Pendant l’hiver 2000-2001, le zoud, la tempête
de neige et des températures de moins vingt à moins trente
degrés, ont anéantis les troupeaux les plus fragiles. Pour
l’instant, se sont seulement les rapaces qui tournent au-dessus de nous,
en attendant patiemment que nos carcasses sèchent au soleil.
C’est aujourd’hui, après trois jours de piste et de poussière,
en arrivant à Karakorum, que nous allons faire connaissance avec
l’ultime transformation du lait : l’airak. Le lait de jument fermenté.
Une véritable friandise liquide, l’objet de toutes les attentions,
une spécialité que les autochtones ne manquent jamais de vous
faire partager, et vous ne pouvez vous y soustraire, sous peine de lire rapidement
l’incompréhension et la déception dans les yeux de ces gens
pour qui l’accueil est une seconde nature, un véritable sacerdoce.
Karakorum, rien que le nom résonne comme un coup de tonnerre, une
invitation à parcourir ces grandes plaines, jour après jour,
au gré des saisons, des transhumances. C’est un livre d’histoire qui
s’ouvre devant vous. Karakorum fût la capitale de la Mongolie, mais
seulement pendant trois dizaines d’années. Une des raisons, en est
la situation centrale qui permit à Gengis Khan d’en faire un centre
militaire de première importance. Karakorum connût ainsi un
certain faste pendant un siècle et demi. Il n’en reste que peu de
chose aujourd’hui. Comme Mörön, plus au nord, c’est une ville de
maisons basses en briques ou en bois ; De grandes artères séparent
des pâtés de maisons entourées de palissades également
en bois. C’est un peu une ville comme on en voit dans les westerns. Pas d’eau
courante, pas d’évacuation d’eaux usées, mais l’électricité.
Pas 24 heures sur 24, mais si tout va bien vous avez du courant quatre à
six heures par jour. Mais Karakorum, c’est aussi le monastère d’Erden-Züü,
le plus ancien, le plus important et le plus grand monastère bouddhiste
de toute la Mongolie. C’est devant l’entrée de ce monastère,
que le camion s’arrête une fois de plus.
Nous descendons tous, secouons la poussière de nos vêtements,
comme les sept mercenaires, n’ayons pas peur des mots ! Et restons pantois
devant l’ampleur de la construction. A l’intérieur d’une enceinte
de 400 mètres de côté, il ne reste plus que trois temples
sur les soixante qui ont été construits entre le 16ème
et le milieu du 19ème siècle. D’ailleurs, ces temples ont
été, pendant des centaines d’années, beaucoup détruits
et aussi beaucoup reconstruits, jusqu’à la situation actuelle où
ne subsistent plus que trois temples debout. Les autres ont subi les assauts
du totalitarisme communiste. Les profonds changements que nous connaissons
dans la société communiste depuis peu, ont permit un retour
progressif aux pratiques bouddhistes et le retour des moines à Erdeen-Züü.
Un petit musée est ouvert, en parallèle avec l’activité
monastique. Les uns derrière les autres, nous pénétrons
dans l’enceinte d’un temple en suivant les dalles cimentées. Nous
tournons les moulins à prière, avant de rentrer dans le bâtiment.
Une odeur lourde et âcre nous prend à la gorge. Tulga, entré
le premier, interroge les quelques moines en prière, et nous fait
signe : "entrez, entrez, par la gauche, derrière moi et surtout ne
faites pas de bruit !".
D’un hochement de tête entendu, nous obtempérons. Les moines
psalmodient de longues mélopées, au milieu des lampes à
huile. Après avoir fait le tour d’une sorte d’autel en U, une jarre
attire l’œil de Tulga. Une courte phrase à l’attention d’un moine,
et il nous fait signe d’approcher. Circonspects, nous nous groupons autour
de l’objet. C’est une cruche, d’environ 10 litres, d’airak, nous informe
Tulga la mine gourmande. Je vois différentes "choses" flotter à
la surface. Mouches, cheveux et…je ne veux pas connaître le reste.
Nous nous regardons, ne sachant que faire, quand Tulga trempe un bol dans
la jarre, le porte à sa bouche et avale son contenu voluptueusement.
Le bol retourne à la jarre et se retrouve devant le nez de Bernard.
Je ne vois pas sa tête. Bernard porte le bol à ses lèvres,
ingurgite une partie du liquide, puis le transmet à Pierre-Marie sans
s’être évanoui. C’est quand même bon signe ! Pour Pierrre-Marie,
c’est différent. Je vois ses yeux tourner dans leurs orbites, je sens
le liquide rouler dans sa bouche, et j’imagine son cerveau en train de lancer
des messages désespérés : SOS ! SOS !
"Pierre-Marie ! ne crache pas, ne crache pas, les moines sont trop près",
lancé-je avec un regard insistant. Bernard est sorti, lui, pour s’aérer.
Pierre-Marie me tend le bol, et en apnée, la mine livide, sort précipitamment.
Le bol à la main, immobile, me sentant observé, je ne fais plus
un geste pendant un temps qui me paraît éternel, quand Tulga
me pousse : "Philippe, dépêche-toi, on n’a pas la journée
! je suis obligé de m’exécuter. Le bol monte lentement, la
surface du liquide augmente démesurément, au fur et à
mesure que le bol se rapproche. L’odeur, fade, âcre de lait caillé,
m’envahit. C’est l’odeur qui nous sautait au visage et à l’odorat
en entrant dans le bâtiment. Mes lèvres troublent la surface
du liquide, qui m’investi lentement la bouche J’ai vomi, je viens de vomir.
Non, pas du tout, ce n’est pas ça ! c’est le goût du liquide
que j’avale péniblement qui me ramène durement à des
jours anciens de beuveries, avec ce résultat. Sauf qu’aujourd’hui,
ce vomi, je ne le crache pas, je l’avale ! Dominique passe l’épreuve
également. Pas si mauvais que ça trouve-t-il, cherchant ce
qui peut nous mettre dans cet état.
"Enfin ! dit Tulga, impatient. Moi, j’en reprendrais bien une petite louche.
Joignant le geste à la parole, le bol plonge dans la jarre, et l’œil
pétillant devant une telle merveille, Tulga s’exécute sans se
faire prier, plongeant et replongeant le bol, jusqu’à plus soif. Rassasié,
ravi, il contemple nos mimiques, nos mines déconfites et Pierre-Marie
crachant et recrachant de toutes ses forces, à l’abri des regards.
Plus ou moins pâles, nous nous regardons en espérant ne pas
avoir à renouveler l’expérience trop souvent.
Remontés en camion, la piste nous emmène à nouveau
et de plus en plus loin, vers l’ouest. Quand je pense que nous avons imaginé
louer ce camion et le conduire nous-mêmes ! Quelle forfanterie de
notre part, quand on découvre la réalité de la piste
; enfin des pistes. Des pistes qui divaguent au gré des envies de
chacun. Une piste, trop détruite, se trouvant remplacée par
une autre piste parallèle, elle-même accompagnée par
une ancienne piste qui sera réutilisée un jour. Ces bras se
séparent comme des bras de rivière dans un delta, comme les
bras d’un poulpe géant autour des collines environnantes et sur des
centaines de kilomètres. Et, si depuis quatre cent kilomètres,
nous avons changé de direction… deux fois, sans chauffeur expérimenté,
nous serions déjà à tourner en rond, perdus comme des
poissons rouges dans l’océan pacifique. Nous roulons ainsi jusqu’à
vingt heures trente, un panache de poussière d’environ deux cent mètres
accroché au camion comme à une diligence de la Wells Fargo
d’une époque bien révolue, ou plus poétiquement à
une traîne de comète dans l’azur immaculé. Les étoiles
s’accrochent maintenant au velours du ciel, alors que les tentes se reflètent
dans la mare d’eau salée devant laquelle nous sommes installés
; la lune nous sourit béatement, inondant la plaine d’une lueur fantasmagorique.
Jeudi 30 août
Sept heures. L’astre solaire remplace en douceur l’astre de la nuit. Malgré
notre sensation d’isolement, quelques gers fument dans le lointain ; malgré
l’immensité et la faible densité de population, nous ne sommes
jamais vraiment seuls. Chaque pause, chaque repas, voit un visiteur, le
plus souvent à cheval, s’arrêter, même dans le noir le
plus total. Nous entendons d’abord le galop du cheval, puis, surgit un cavalier
en del, dans la lueur du feu de camp, comme un fantôme, qui vient
s’asseoir prés de notre camp. Quelques mots s’échangent avec
nos guides, puis une assiette lui est tendue. Le repas partagé, les
cigarettes échangées, il repartira, toujours dans le noir,
vers une destination qui nous semble irréelle. Maintes fois, le scénario
se reproduira. C’est ainsi que l’on accueille le voyageur, dans ces pays
de solitude.
Ce matin, nous tentons une toilette sérieuse après le café
et les biscuits. Une louche d’eau pour le visage et les mains et nous voilà
fins prêts .La province de l’Arkangaï, ou Kangaï du nord,
n’offre que peu de différences avec la province de Töv. 10%
de la surface de la France, cent dix mille habitants, et une altitude moyenne
d’environ deux mille quatre cent mètres. Dans une magnifique continuité,
les plaines continuent à dérouler leur tapis de pâturages
abondants et de rivières pures et fraîches.  A l’infini,
des camps de gers, des troupeaux de chevaux, de yacks. Après quatre
cent cinquante kilomètres depuis Ulaan-Bator, nous arrivons aux portes
de la ville de Tsetserleg, littéralement le "jardin vert", et capitale
de la province. Nous ne pourrons y pénétrer. Pour des raisons
obscures, des travaux paraît-il, nous devrons rebrousser chemin, et
trouver notre voie à travers la plaine, pour atteindre le lac Terkhin
Tsagaan , ou Terkhin Tsagaan Nuur (Nuur pour lac), le premier des lacs devant
recevoir la visite de plongeurs français. L’après-midi passera
à la recherche d’une hypothétique piste à travers collines,
forêts et rivières au franchissement hasardeux et aléatoire,
mais avec l’avantage sur les ponts en bois, c’est que le fond de la rivière,
on le voit, alors que l’on ne voit pas ce que nous réserve la traversée
d’un pont ! Et parfois, dans le doute, le passage à gué semble
infiniment préférable à l’autre solution. Même
si parfois, moteur noyé, nous devons "faire la pause" en travers
du courant, au milieu de la rivière. Dans le milieu de l’après-midi,
toujours avec un chaud soleil, nous arrêtons près d’une rivière
limpide d’une dizaine de mètres de large. Le camion débarque
une équipe de pêcheurs surexcités d’enfin tremper du fil,
et à l’occasion, d’améliorer les menus quotidiens. Les préparatifs
sont brefs ; Pierre-Marie et Bernard partent rapidement, l’un en aval, l’autre
en amont, avec l’espoir de "sortir" les premiers poissons. Je dois dire qu’ici,
la pêche n’est pas l’activité principale des mongols, même
si quelques uns s’y mettent, mais avec d’autres méthodes, méthodes
que nous qualifierons de préhistoriques, mais diablement efficaces.
Si efficaces que notre matériel, de pointe paraîtra parfois
parfaitement obsolète.
A l’infini,
des camps de gers, des troupeaux de chevaux, de yacks. Après quatre
cent cinquante kilomètres depuis Ulaan-Bator, nous arrivons aux portes
de la ville de Tsetserleg, littéralement le "jardin vert", et capitale
de la province. Nous ne pourrons y pénétrer. Pour des raisons
obscures, des travaux paraît-il, nous devrons rebrousser chemin, et
trouver notre voie à travers la plaine, pour atteindre le lac Terkhin
Tsagaan , ou Terkhin Tsagaan Nuur (Nuur pour lac), le premier des lacs devant
recevoir la visite de plongeurs français. L’après-midi passera
à la recherche d’une hypothétique piste à travers collines,
forêts et rivières au franchissement hasardeux et aléatoire,
mais avec l’avantage sur les ponts en bois, c’est que le fond de la rivière,
on le voit, alors que l’on ne voit pas ce que nous réserve la traversée
d’un pont ! Et parfois, dans le doute, le passage à gué semble
infiniment préférable à l’autre solution. Même
si parfois, moteur noyé, nous devons "faire la pause" en travers
du courant, au milieu de la rivière. Dans le milieu de l’après-midi,
toujours avec un chaud soleil, nous arrêtons près d’une rivière
limpide d’une dizaine de mètres de large. Le camion débarque
une équipe de pêcheurs surexcités d’enfin tremper du fil,
et à l’occasion, d’améliorer les menus quotidiens. Les préparatifs
sont brefs ; Pierre-Marie et Bernard partent rapidement, l’un en aval, l’autre
en amont, avec l’espoir de "sortir" les premiers poissons. Je dois dire qu’ici,
la pêche n’est pas l’activité principale des mongols, même
si quelques uns s’y mettent, mais avec d’autres méthodes, méthodes
que nous qualifierons de préhistoriques, mais diablement efficaces.
Si efficaces que notre matériel, de pointe paraîtra parfois
parfaitement obsolète.
En attendant les poissons, pour l’instant une simple vue de l’esprit, Tulga,
prudent, prépare un repas. Gamba et Onour sont repartis pour trouver
de l’essence. Cet aspect important du voyage, l’essence, ne manque pas de
nous inquiéter. Plusieurs pompes croisées sur la piste se sont
révélées vides. Quelques dizaines de litres sont venus
alimenter le réservoir affamé, à une pompe où
l’électricité manquant, c’est à la manivelle qu’il faudra
faire monter l’essence de la cuve au réservoir. Pour l’instant et en
attendant le retour du camion, en short et torse nu au bord de la rivière
tels des touristes moyens, Dominique et votre serviteur, profitent sans remords
du temps, du paysage, du silence, silence qui nous fait tellement défaut
dans notre vie quotidienne. La pêche ne sera par miraculeuse, mais quelques
ombres et truites lenok, alimenteront agréablement le repas de ce
soir. Il faut préciser, que la pêche de la truite lenok, race
endémique au bassin hydrologique mongol, était prévue
dès le départ pour tenter de rendre le quotidien disons plus
confortable. Mais l’objet de tous les fantasmes, de toutes les convoitises,
c’est le huchon taïmen, le plus grand salmonidé et le plus grand
poisson d’eau douce du monde. Un monstre dont les plus grands représentants
peuvent atteindre deux mètres et quatre-vingt kilos. Inutiles de
vous dire que pour nos deux compères, c’est plus qu’une pêche
; c’est une chasse, une traque de tous les instants chaque fois que l’eau
sera à portée de canne à lancer. Ce poisson mythique
fait fantasmer Pierre-Marie et Bernard plus qu’il n’est raisonnable. Mais
allez parler de raison à des passionnés ! Peine perdue, plus
de son, plus d’image, juste un pur esprit relié à un poisson
par un fil ténu, avec tous les accidents, casse par exemple, qui vont
transformer le rêve en cauchemar. Nous en ferons hélas, l’expérience.
Pour le huchon taïmen, comme pour la truite lenok, septembre n’est pas
forcément la période idéale. Pour ces migrateurs, les
lieux de pêche sont différents en été et en hiver.
Pas de chance, pour le huchon, la période la plus favorable, c’est
le printemps !
Cette pêche utilise des méthodes particulières. Ici,
l’appât, c’est un rat mort. La taille et l’appétit de ce prédateur
redoutable, fait qu’un rat mort au bout d’une ligne, n’est rien d’autre qu’une
modeste friandise. Seulement quand un poisson de vingt ou trente kilos mord
à cet appât, c’est une véritable guerre qui s’engage.
Aujourd’hui, la guerre des gaules n’aura pas lieu. Le huchon est ailleurs,
ou n’a pas d’appétit, allez savoir. Néanmoins, ces quelques
poissons vidés par des mains expertes, sont les bienvenus. Gamba et
Onour de retour avec de l’essence, nous pouvons passer "à table".
Non contents d’avoir fait le plein, Gamba et Onour ont fait quelques courses,
et rapporté divers morceaux d’un plat national : la marmotte. Pierre-Marie
prétextant un début de dérangement intestinal, échappera
à la dégustation, mais Dominique et moi-même goûterons
à ce qui est pour les mongols, un apport alimentaire substantiel.
C’est sans problème pour des mangeurs de viande comme nous. Le plus
malheureux, c’est Bernard dont les habitudes alimentaires sont assez éloignées
de ce qu’il est obligé de subir en expédition. Tirer nos deux
pêcheurs de bord de l’eau n’est pas chose aisée. Nous reprenons
la piste pour le point le plus à l’ouest de notre périple, le
lac Terkhiin Tsagaan , que nous atteindrons vers vingt-deux heures trente,
cela signifie encore six heures de piste après la pause pêche.
La nuit est au rendez-vous à l’approche du lac. A la noirceur environnante,
s’oppose le scintillement du lac, qui s’étend sur une vingtaine de
kilomètres. Un petit replat nous accueille, quelques dizaines de mètres
au-dessus du lac, permettant une fois de plus une installation aisée,
avec "vue sur le lac" imprenable. Nous n’avons, une fois de plus, pas à
partager ce magnifique endroit avec trois mille campeurs et deux cent caravanes.
Le groupe électrogène en route, le montage des tentes et la
préparation du repas sont grandement facilités. Les péripéties
de la journée et les kilomètres pèsent sur les épaules.
Point n’est besoin de nous pousser pour rejoindre les duvets. Morphée
nous tend les bras et nous nous abandonnons sans réserve.
Vendredi 31 août
Aujourd’hui est un grand jour. Avec l’appréhension que vous
imaginez, je quitte les plongées en piscine, pour une piscine un peu
plus grande. Dominique n’est pas sans se poser des questions. Il sait où
il va lui, mais accompagné d’un débutant, il lui faudra pas
mal de sang froid pour gérer ce moment. Pour l’instant, le soleil au
lever de l’équipe, est toujours avec nous, avec tout ce que cela signifie
pour Pierre-Marie, d’images à réussir. Les visiteurs se succéderont
toute la matinée à notre camp installé à une
encablure de la piste. En voiture, à cheval, la curiosité se
fera insistante autour du matériel de plongée, que Dominique
et moi-même avons étalé sur une couverture. Combinaisons,
palmes , ceintures de plomb, masques, détendeurs, tout cet attirail
intrigue, et chacun de toucher, palper, examiner, inspecter avec les interrogations
que les habitants des gers voisines ne manquent pas de se poser sur l’utilité
de ce matériel jusqu’alors jamais vu. Plus loin, les bouteilles branchées
au compresseur se remplissent. Douze litres de volume chacune, soit environ
à deux cent bars de pression, plus de deux mille litres d’air comprimé
et trente à quarante minutes d’autonomie.
Mais pour l’instant, la visite la plus remarquable, est un jeune et magnifique
mongol à cheval, en del, la carabine en bandoulière, et un étrange
butin accroché à la selle. Il est jeune, malgré la difficulté
à lui donner un âge ; pour nous, une vingtaine d’années.
Au pas, il s’approche lentement, arrête le cheval et met pied à
terre. Comme chaque fois, c’est une occasion supplémentaire de parler
pour nos guides. Et pour nous, d’apprendre les us et coutumes de ce pays
surprenant. Nous nous approchons tous du cheval pour constater avec surprise,
que sont accrochées au flanc de la selle, des marmottes. C’est maintenant
la saison de la chasse pour ces animaux parfaitement protégés
en France. Ici, c’est un apport de nourriture absolument essentiel, et les
trois mois autorisés pour cette chasse, sont amplement remplis. Différentes
techniques sont utilisées. Tout d’abord l’affût. Rien de bien
nouveau par rapport aux techniques européennes. Une seule qualité
: la patience. Allongé sur le sol, la carabine posée sur son
trépied, le chasseur ne peut qu’attendre que la marmotte sorte de
son trou pour l’abattre. Cela peut sembler cruel pour ces charmantes bestioles,
mais dites-vous, que les chasseurs font la même chose chez nous avec
les lapins, les pigeons et autres volatiles. Les marmottes sont extrêmement
nombreuses, et il ne faut rater la "saison" sous aucun prétexte.
Et si chez nous elles se laissent facilement approcher, ici, la méfiance
est naturelle comme pour tout gibier face à son prédateur.
Les marmottes, ont hélas, un grand défaut, la curiosité.
Face à cette particularité, les mongols savent intéresser
l’animal, par une sorte de rituel, de danse qui ne manque pas d’attirer
l’animal hors de son trou. Habillé le plus souvent de blanc, le chasseur
entame une espèce de danse, de sautillement, en agitant une sorte
de plumet également blanc de crin de cheval au bout d’un bâton
comme s’il s’agissait d’une queue. La marmotte n’y tenant plus de curiosité,
laisse ainsi le chasseur s’approcher, jusqu’au coup de grâce.
Le
passage de ce chasseur, va permettre à nos guides de "commercer", et
ainsi s’offrir une de ces marmottes, que Onour, Gamba et Tulga regardent déjà
d’un œil gourmand. La transaction réalisée, un autre rituel
va commencer. D’abord faire un feu, puis le feu en marche, mettre une douzaine
de galets à chauffer. Pendant ce temps, la marmotte est ouverte, vidée
puis recousue. Pour l’instant, la marmotte possède encore sa fourrure.
Le feu ayant rempli son office, les pierres brûlantes, saisies avec
une pince sont introduites dans la bête par l’orifice disponible, une
fois la tête coupée, dans un étrange et repoussant bruit
de combustion, de chair brûlée. Alternativement, pierres et
légumes (carottes, pommes de terre, oignons, navets) viennent remplir
et gonfler l’animal, jusqu’au moment où l’on attache le cou de la
marmotte avec du crin de cheval trempé dans l’eau, assurance de solidité.
Ensuite, le corps gonflé, rebondi, devient plus facile à nettoyer
de ses poils, opération réalisée au chalumeau. La vue
du poil qui noircit, grésille, dans une odeur forte et âcre,
n’augure pas un excellent repas pour Pierre-Marie, l’œil collé à
l’objectif de la caméra à dix centimètres de l’opération,
et pour Bernard dont on connaît l’aversion pour les repas carnés.
Il faut imaginer que toute cette opération a pris deux bonnes heures,
et que le repas de midi, pour nous européens, sera dégusté
vers seize heures. Nos guides trouveront toujours surprenante cette habitude
des repas à environ, douze treize heures et dix-neuf, vingt heures.
Ils ne comprendront jamais ce besoin de s’alimenter à heures fixes,
alors que pour eux, la solution est de s’alimenter…seulement quand on a
faim ! C’est tellement logique. Mais ici, le temps n’a pas la même
longueur, la même signification, les mêmes impératifs.
Néanmoins, nous déjeunerons et dînerons tous les jours
! Arrive l’heure, où la marmotte, cuite, se transforme enfin en repas.
Tous accroupis autour de notre futur repas, Onour officie. La marmotte est
à nouveau ouverte, et les légumes s’entassent dans un plat,
pendant que les pierres encore brûlantes sont distribuées à
chacun d’entre nous. Nous faisons sauter les pierres d’une main dans l’autre,
d’abord parce que ça brûle ! et qu’ensuite cette coutume est
le gage pour chacun de rester en bonne santé. Le jus de cuisson est
versé dans un bol qui fait le tour de l’assemblée, sauf qui
vous savez ; et quand la marmotte est enfin découpée, pierre-Marie
et Bernard n’ont plus faim. Avec Dominique, nous ferons honneur à
nos guides qui apprécieront ce partage.
Les bouteilles gonflées, il faut y aller. Le lac nous offre
ses eaux sombres, et nous ne saurions le faire attendre plus longtemps. Le
plus dur, enfiler la combinaison deux pièces, réellement un
peu petite. L’opération terminée, je suis déjà
fatigué. Dominique et Pierre-Marie installent la caméra dans
son caisson étanche, les projecteurs sont fixés sur leur support,
et harnachés de la tête aux pieds, nous parcourons les quelques
dizaines de mètres, en pente douce, qui nous séparent de l’eau.
Le moment de vérité est arrivé. Les palmes aux pieds,
le détendeur à la bouche, à reculons je pénètre
dans l’eau. Je n’ai pas de sensation de froid. Seule un peu d’angoisse m’étreint.
Normal. Dominique me rejoint et lentement nous éloignons et disparaissons
sous l’eau. Je n’ai pas froid, je surveille manomètre et profondimètre,
sans m’éloigner de la présence sécurisante de Dominique.
Rapidement nous atteignons moins cinq mètres sur un fond de sable
légèrement herbeux. Par contre, l’eau et tellement trouble,
chargée de plancton, qu’à un mètre, je ne vois plus
Dominique. C’est un vrai problème, auquel vient s’en ajouter un nouveau
: les oreilles me font souffrir. J’ai pourtant tenté de compenser
la pression de l’eau, en passant sous la surface, malgré cela, les
tympans ne "passent pas". Je remonte un peu, dégurgite pour rééquilibrer
et repousser les tympans et redescend à nouveau. Sans succès,
à moins cinq mètres, ce qui est peu, j’ai mal. Je fais signe
à Dominique que je remonte, et le laisse continuer seul. Cette première
plongée est une déception. Je retrouve la surface à
quelques centaines de mètres de la rive. Sur le dos, je gonfle le
gilet stabilisateur et palme lentement vers mes camarades qui m’attendent
anxieux, en s’interrogeant sur le motif de mon retour solitaire. Arrivé
au bord, mes compagnons m’aident à m’extraire du gilet et de la combinaison
qui m’étouffe. Le soleil qui darde de puissants rayons fini de m’asphyxier,
et me laisse sur le bord pantelant, épuisé et les intestins
à nouveau en révolution.
-"Les oreilles ne passent pas", expliqué-je à mes compagnons,
attentifs à mes paroles. Dominique continue seul, cela ne me plaît
pas trop, mais c’est un pro, il sait ce qu’il fait.
Néanmoins, on ne peut empêcher de repasser des idées
pas très agréables.
C’est quand même un baptême de plongée. Vendredi 31
août, seize heures trente, durée : quinze minutes, moins cinq
mètres, température de l’eau : quatorze degrés.
Notre soulagement n’est pas feint quand nous repérons les bulles
à la surface, puis une tête qui se dirige vers nous. Dominique,
quelques minutes plus tard, débarrassé de la caméra,
de son équipement, s’explique :
-"Mauvaise plongée, peu intéressante. L’eau est trop chargée,
la visibilité extrêmement réduite. Je n’ai pu utiliser
les possibilités de la caméra. De plus, je n’ai vu aucun poisson.
C’est une plongée déception pour moi aussi, fait Dominique,
se rapportant à mon retour prématuré. La caméra
sortie du caisson, Pierre-Marie s’applique à vérifier que les
remarques de Dominique, sont hélas bien réelles.
-"Dommage, fait Pierre-Marie, un regard également lourd de déception.
C’est quand même une mauvaise surprise de trouver des eaux aussi troubles,
dans ces contrées plutôt désertiques. La présence
humaine est fort modeste, les courants pratiquement nuls et la pollution apparemment
inexistante.
-"C’est vrai, rétorque Dominique débarrassé de sa
combinaison qui sèche au soleil, mais le lac Khövsgöl nous
sera peut-être plus favorable.
Vers dix-huit heures, le matériel de plongée rangé
dans le camion, nous décidons de ne pas rester sur cette mauvaise impression,
et tentons un nouvelle opération pêche au lancer, qui malgré
notre persévérance, sera aussi infructueuse que la chasse aux
images sous-marines.  Nous décidons quand même que rien n’entamera la bonne
humeur générale, et nous profitons d’une extraordinaire soirée
en cinémascope, avec les collines verdoyantes derrière nous,
le scintillement du lac à nos pieds, le campement au milieu, et la
voie lactée au-dessus.
Nous décidons quand même que rien n’entamera la bonne
humeur générale, et nous profitons d’une extraordinaire soirée
en cinémascope, avec les collines verdoyantes derrière nous,
le scintillement du lac à nos pieds, le campement au milieu, et la
voie lactée au-dessus.
Le lac Terkhiin Tsagaan ne nous aura livré ni ses secrets, ni ses
poissons ! Mais la richesse humaine, la richesse du voyage s’accumule en
nous, sans limite, sans pouvoir rassasier le trou sans fond de notre appétit
de vivre.
Plein nord. Plein nord pendant 400 kilomètres, vers Möron, Khatgal
à l’embouchure du lac Khövsgöl. Ce lac, la "Perle Bleue"
de Mongolie, va se déverser dans le lac Baïkal, la plus grande
réserve d’eau douce du monde, auquel il est relié par la rivière
Egin Gol. Cette province du Khövsgöl, au nord-ouest du pays porte
donc le nom du lac le plus profond de Mongolie, 260 mètres, pour 135
kilomètres de long, et 35 kilomètres de large. C’est le second
objectif liquide de notre expédition, avec l’espoir qu’il nous laissera
filmer ses entrailles. Le paysage change ; des plaines centrales il ne reste
rien, remplacées par la montagne, et la taïga a disparu au profit
des sombres forêts de cèdres, bouleaux et mélèzes.
Un peu plus haut, à environ deux cent kilomètres, la Sibérie.
Le campement est établi ce soir à l’embouchure du lac, avec
un peu de froid et de pluie.
Pendant deux jours, la piste nous a offert les pièges habituels,
trous, ravines, fondrières franchis à cinq kilomètres-heure.
Bernard aura raté un des rares, très rares taimens croisés
sur notre route. Un animal d’environ 12 à 14 kilogrammes, qu’il va
tirer, après une longue bataille, jusqu’au bord, dans vingt centimètres
d’eau, et perdre à la dernière seconde, dans un dernier sursaut
du poisson qu’il regardera, déconfit, rejoindre les profondeurs de
la rivière. Stress, surprise, nous ne savons, mais ce poisson sera
l’objet de longues discussions, en dehors du fait que ce sont quelques repas
que nous regardons retourner à la rivière ! Dominique et moi-même,
pauvres amateurs, sans espoir d’attraper ce poisson-roi, alimenterons quand
même copieusement le groupe avec quelques truites lenok de 50 à
60 centimètres qui feront notre fierté. Bernard songera longtemps
à se recycler aux dominos, aux cartes ou au tricot, le succès
ayant décidé de le fuir obstinément.
Ce soir, il fait frais et humide, mais le plat de mouton préparé
par Tulga fleure bon, et nous l’honorons comme il se doit. Dominique ne
peut s’empêcher de plonger dans le plat, c’est sa nature ! ainsi que
Pierre-Marie, dont les résolutions alimentaires du départ
sont tombées à l’eau, comme ses illusions sur le taimen.
Lundi 3 septembre
Une aube frileuse se lève après une nuit pluvieuse et fortement
ventée. Il faut attendre 10 heures pour sentir le soleil réchauffer
nos muscles endoloris par le couchage sommaire, les journées trop
longues et les nuits trop courtes, à mon goût. Nous remontons
lentement la rive gauche du lac Khösvgöl jusqu’à un premier
camp pour touristes. L’un des rares camps installés
en Mongolie, et susceptibles d’accueillir, allez, cinquante personnes ! C’est
vrai, nous sommes un peu loin de la côte d’azur ou des Baléares.
Remarquez, je n’ai rien contre les Baléares, c’est très bien
les Baléares. Mais ici, pour le shopping, les petits cafés
en terrasse et les nuits en boites, il n’y a rien à moins de… 700
kilomètres et cinq jours de piste, un détail !
L’un des rares camps installés
en Mongolie, et susceptibles d’accueillir, allez, cinquante personnes ! C’est
vrai, nous sommes un peu loin de la côte d’azur ou des Baléares.
Remarquez, je n’ai rien contre les Baléares, c’est très bien
les Baléares. Mais ici, pour le shopping, les petits cafés
en terrasse et les nuits en boites, il n’y a rien à moins de… 700
kilomètres et cinq jours de piste, un détail !
Ce camp est l’occasion de trouver un moyen pour nous aventurer sur
le lac, et plonger plus au large. Pas simple car les engins de susceptibles
de naviguer sont de deux tailles. Une barque de trois mètres et un
bateau, un fort beau bateau de… 15 à 18 mètres. Bien sûr
nous nous mettons à rêver de la Calypso, et à se prendre
pour Cousteau et son équipage. Malheureusement, le prix, trois cent
dollars, ce qui peut sembler modeste, nous ramène sur terre. De longues
négociations entre Pierre-Marie, Bernard et l’équipage n’aboutirons
pas. Nous aurons rêvé. Nous abandonnons momentanément
ce projet pour organiser la seconde plongée de Dominique, sans moi,
puisqu’il doit descendre à moins trente mètres. A quatorze heures
cinquante, de nouveau équipé, avec caisson étanche, projecteurs,
Dominique s’enfonce à nouveau sous les eaux. Pour les six membres
de l’équipe, c’est en même temps une période de repos,
au soleil qui s’obstine à nous accompagner chaque jour, malgré
un vent plus frais, et une période d’attente intenable qui commence.
Nous avons tous déclenché les chronomètres qui égrènent
chaque seconde des quarante minutes que doit durer la plongée. Une
éternité plus tard des bulles apparaissent, puis une tête
sort de l’eau. Vivant et entier, dire que c’est un soulagement est un peu
faible. Imaginez un problème de plongée ici ! Pas de médecin,
de caisson de décompression, rien.
-"C’est mieux en ce qui concerne la visibilité, fait Dominique un
fois sorti de l’eau. Le fond est un fond à nouveau de sable et d’herbe,
et j’ai quand même croisé quelques poissons, mais très
peu." dit-il alors que nous l’entourons avides d’informations.
"Rien de plus ?" demande pierre-Marie qui accuse le coup.
-"rien de plus, en tout cas guère mieux sauf la clarté de
l’eau" en termine Dominique en mettant sa combinaison à sécher
sur le camion, pendant que nous rangeons le reste.
Nous nous regardons tous, ne sachant comment réagir ; tristesse,
déception, colère. Mais non, la moisson n’est pas finie, et
les eaux du lac Khövsgöl vont continuer à nous accueillir
pendant quelques jours. C’est suffisant pour que la chance tourne. Nous rejoignons
ce soir un petit camp de touristes, désert à cette époque,
où quelques personnes restent pour gérer d’éventuelles
demandes, jusqu’à la fermeture définitive vers le 30 septembre.
Puis de janvier à mai, le lac se figera sous l’emprise du froid, et
servira de raccourci pour les véhicules qui pourront ainsi, pendant
quelques mois éviter la piste, fort mauvaise, qui longe le lac. Ce
camp, six à huit gers, au milieu d’un bosquet de sapins, va nous servir
de camp de base pour les jours à venir. Pour les prochaines plongées,
et pour la randonnée à cheval qui doit nous permettre d’atteindre
un sommet proche d’où nous pourrons avoir une vue plus vaste sur ce
lac. Nous investissons deux gers, et allons dormir quelques nuits sur des
matelas. La différence avec les gers des campagnes, c’est le plancher
en bois à la place des tapis, ou de la terre. Mais la construction
est la même avec le poêle au milieu, le trou au sommet qui nous
vaudra quelques réveils un peu frais, puisqu’il gèlera dans
la tente le matin. Mais, quel confort !
Ce camp, c’est un petit peu le paradis, enfin notre paradis. Vous imaginez
qu’il y a des toilettes avec l’eau courante, des douches ! Il n’en sort
qu’un filet d’eau gros comme le doigt, mais c’est un filet d’eau chaude.
Nous atteignons les sommets du luxe avec un petit restaurant, à l’écart
des tentes, avec une petite pièce d’une douzaine de mètres
carrés, pouvant accueillir dix à quinze personnes. Une grande
baie vitrée donne sur le lac à une trentaine de mètres.
Nous userons et abuserons de cet établissement où vont se succéder
les dégustations de cuisine et boissons locales.
Mardi 4 septembre
Aujourd’hui, Dominique et moi retournons à l’eau. Equipés,
nous partons pour une plongée qui a duré quarante minutes.
Par un fond de sable, à cinq mètres, inondés des rayons
du soleil qui flirte avec les algues grâce à une eau cette fois
limpide, sauf quelques lottes d’eau douce évidemment (lotta, lotta),
rien qu’un grand vide. A notre retour, la déception de nos amis n’est
pas feinte.
-"Comment ! s’exclame Pierre-Marie, toujours rien" Nos mines sont sans
appel.
-"Non répond Dominique. Ce lac qui devait se révéler
une mère nourricière, n’est en fait qu’un grand garde-manger
vide".
-"Il faudra, ajoutai-je en m’extirpant difficilement de mon accoutrement,
remettre en place de doux rêveurs, qui ont longtemps fantasmé
sur la prodigalité de ce lac."
Bernard reste coi, ses illusions sur la pêche sont tombées
à l’eau depuis longtemps. Au moins nous ne souffrons pas du froid
dans l’eau. De plus c’est une plongée réussie pour moi. Collé
à Dominique, j’ai surveillé les appareils : manomètre
de pression d’air, profondimètre. Pas d’eau dans le masque et je profite
de mes huit mois d’entraînement en piscine lors de cette nouvelle plongée.
Le matériel remonté dans les gers et les combinaisons mises
à sécher, une nouvelle arrive par l’entremise de nos guides,
qui n’ont pas perdu leur temps pendant notre absence sous-marine.
Tulga : "Nous avons découvert un camp tsaatan à quelques
kilomètres. La femme de ce camp est chamane. Elle communique avec
les esprits. Nous avons parlé, elle accepte que nous lui rendions
visite. Tous subjugés par ces révélations, nous voulons
en savoir plus. Les questions fusent : "où sont-ils, combien, quand
? Tulga sourit : "Ce soir." Pierre-Marie remonte précipitamment fourbir son matériel,
Dominique et moi nous reposer.
Pierre-Marie remonte précipitamment fourbir son matériel,
Dominique et moi nous reposer.
Les tsaatans, l’éthnie un peu mystérieuse de ces contrées.
La seule, et dernière population à élever des rennes.
Bientôt, ils auront complètement disparus. Ils ne sont au plus,
que quelques centaines de familles à vivre dans ces immenses contrées
perdues, à l’est du lac. Cette ethnie n’est pas une ethnie mongole
à proprement parler, mais ils sont d’origine Turque. Leur habitat est
d’ailleurs différent de l’habitat mongol puisqu’ils n’habitent par
la ger, mais la tente sous la forme tepee indien. C’est une chance inouïe
pour nous. Ils sont installés à quelques kilomètres,
un peu en retrait du lac, au pied de ces montagnes dont le plus haut sommet
au dessus du lac est le Khuren Uul qui culmine à 3020 mètres.
Nous attendons beaucoup de ce rendez-vous pour neuf heures ce soir, et prions
pour pouvoir enregistrer quelques images de ce que s’est engagée Inke
la chamane à nous dévoiler : une cérémonie chamane.
Après un repas au restaurant offert par Gamba où nous
dégustons à nouveau le thé mongol (thé, lait,
beurre et sel), nous nous régalons de boozes. Ce sont d’excellentes
boulettes de viande de veau hachée enrobées de pâte, comme
les raviolis, et cuites à la vapeur. C’est un vrai régal, la
différence est tellement énorme, que quand vous avez mangé
des boozes, vous ne donneriez même pas des raviolis à votre chien.
A vingt et une heures, le moment est enfin arrivé. Equipés
de projecteurs, des caméras et des appareils photos, nous grimpons
dans le camion. Nous commençons par longer le lac par sa rive gauche,
celle où nous sommes installés et après une dizaine
de kilomètres, quittons la piste à gauche pour nous enfoncer
dans la forêt. A nouveau une heure plus tard, dans la pénombre,
un troupeau de rennes, entravés aux pattes, annonce l’arrivée
au camp tsaatan. Entre les sapins, une seule tente. Gamba et Tulga nous précisent
que la chamane est seule ce soir. Son mari et ses enfants ont déjà
déménagé le camp principal, en prévision de
la saison hivernale. Nos guides descendent et pénètrent dans
la tente, pour une fois de plus tenter de nous faire accepter avec notre
matériel, et nos regards sans doute indiscrets.
Une heure d’attente dans le camion plus tard, Tulga et Gamba nous retrouvent.
-"Pas ce soir, déclare Tulga. Inke est fatiguée, ce n’est
pas le bon jour, le bon moment. Peut-être pourrons-nous revenir plus
tard. La stupéfaction et l’incrédulité se lisent dans
les yeux de chacun d’entre nous. Fiasco pour ce soir ; c’est une déception
pour notre raisonnement d’européen. Hors ici, nos valeurs n’ont pas
cours. Les contraintes, les obligations sont à mille lieues des nôtres.
Le retour au camp, a quelque chose d’irréel dans les phares qui
tressautent et trouent la nuit au rythme des cahots de la piste Nous retrouvons
les gers, chargeons les fourneaux, et remettons tous projets… au lendemain.
Mercredi 5 septembre
Un soleil radieux inonde la tente ce mercredi 5 septembre, alors que nous
émergeons à peine de nos duvets, peu encouragés par
la température négative qui nous entoure. Si la matinée
est plutôt calme, nous entreprenons, avec le camion, l’ascension d’un
petit sommet (2600 mètres), qui va nous permettre d’envisager le
lac sur toute sa surface, où presque. Nous reprenons la même
piste que la veille pour aller au camp tsaatan, jusqu’à une bifurcation,
qui nous emmène par une piste assez raide vers le sommet. Quand,
à mi-pente, un bruit vraiment suspect se fait entendre. Nous descendons
rapidement caler les roues du camion avec des pierres. Nous laissons Onour
se mesurer une fois de plus avec la mécanique, et continuons à
pied.
Au sommet, que nous atteignons une heure après, nous pouvons admirer,
dans toute sa splendeur, le lac sacré des Mongols. Nous comprenons
maintenant mieux, les relations fortes entre cette population, et l’eau.
L’eau sacrée, source de toute vie, et garante de la survie. Remarque
valable pour les hommes, et également pour les troupeaux. Les mongols
prélèvent l’eau, dans les lacs, les rivières, pour leurs
besoins bien sûr, mais ne rejettent jamais dans l’eau. Le résultat
est qu’avec une population modeste autour du lac, quatre-vingt-dix cours
d’eau qui se jettent dans le lac, dont la moitié d’eau pure, l’eau
du lac soit particulièrement préservée et à l’abri,
pour l’instant de tout risque de pollution humaine. Ce côté
sacré de l’eau autorise tous les espoirs pour l’avenir de ces régions
isolées, où le tourisme de masse est aujourd’hui une idée
saugrenue. Pas ou peu d’équipements, hébergement… sportif,
pas de loisirs, hormis le cheval, (bonjour les selles en bois), et la pêche
! Pas de magasins, pas de routes. En fait toutes les conditions sont réunies
pour conserver ce sanctuaire dans son état originel.
Nous pensions redescendre pedibus jambus, quand nous apercevons le camion
qui nous a rejoint. Intrigués, nous interrogeons Onour par l’intermédiaire
de Gamba. L’explication nous sidère. Onour est monté, en marche
arrière ! Pas croyable. Nous ouvrons le camion et découvrons
les arbres de transmission à l’arrière du camion vidé
de ses bagages. Conclusion : il nous reste encore deux roues motrices. Par
contre, la suite du voyage semble hypothéquée. Retour au camp
sans encombre et vers vingt heures, Onour avec l’aide de Gamba, monte l’arrière
du camion sur deux billots en bois. Nous n’assisterons pas à l’opération,
qui nous paraît pour le moins délicate, car une plongée
de nuit est prévue.
Reposé, Dominique s’équipe à nouveau pour se mettre
à l’eau vers 22 heures 30. Cette plongée réunit tout
ce que le camp compte d’habitants. C’est-à-dire nous quatre, Olzii
le responsable du camp, sa femme ses enfants, la cuisinière du restaurant
et ses enfants, soit au moins huit à dix personnes. Devant leurs regards
effarés, Dominique se met à l’eau, allume les projecteurs et
s’enfonce dans l’eau noire. La vue des projecteurs sous l’eau transporte
nos amis dans des abîmes de réflexion. Ces deux yeux énormes,
comme les yeux d’un calmar géant illuminent l’eau sur plusieurs mètres.
Et un esprit simple, je veux dire sans connaissance des techniques du monde
moderne, y verrai aisément l’œuvre de Dieu ou du diable, ou de la
magie. De là à réveiller la colère des esprits,
il n’y a qu’un petit pas. Et jusqu’où cela pourrait-il aller ? Mais, quelques dizaines de minutes plus
tard, les grand yeux jaunes, tels les yeux du nautilus réapparaissent
à cinquante mètres du rivage. Lentement, effleurant la surface,
les yeux se rapprochent, Dominique accroché derrière. La faune
ne sera guère plus abondante que de jour. A nouveau quelques lottes,
truites et ombres, mais pas l’abondance dont nous avons rêvé
.La ger, bien chaude, permet à Dominique de se changer confortablement
après les 12 degrés du lac.
Pendant ce temps, avec une lampe torche et quelques outils, Onour à
posé le pont arrière à côté du camion,
changé un roulement conique, refait des joints avec des vieilles pages
de calendrier en carton et remonté le pont, le tout entre 20 heures
et minuit. Alors là, chapeau bas. Le lendemain, nos guides partent
faire un nouvelle tentative auprès de la chamane. Dominique et moi-même,
pour compenser, disons le manque de chance de Pierre-Marie et Bernard, sortons
quelques truites du lac pour un déjeuner qui sera servi vers quinze
heures. Peu importe, c’est un déjeuner. Un peu plus tard, nos guides
reviennent avec de bonnes nouvelles. Nous sommes à nouveau conviés
à une soirée de magie. Cette fois, nous y croyons, nous allons
les faire ces images, enfin peut-être comme disent les mongols. Car
ici, rien n’est sûr, acquis ou garanti. Ces deux mots, resteront gravés
dans nos esprits pendant tout le voyage, et même encore maintenant :
peut-être. Nous allons filmer ce soir, peut-être. Demain, nous
irons pêcher en bateau, peut-être. C’est dire à quel point
les certitudes ici, sont incertaines. Néanmoins, nous reprenons la
piste toujours optimistes, et avec l’espoir de ne pas attendre une heure dans
le camion. Nous y arrivons vers vingt-et-une heures, et cette fois sans attendre,
sommes invités à pénétrer sous la tente.  Dans
la pénombre, malgré le poêle allumé, nous reconnaissons
Inke, aperçue seulement la première fois. Elle n’est pas seule.
Son mari, sa mère, ses enfants sont présents, revenus d’on
se sait où. Nous sommes déjà douze sous la tente de
trois mètres cinquante de diamètre. Nous nous installons difficilement.
Pas de recul pour la caméra, pas de lumière. Nous obtiendrons
péniblement quelques bougies. On fera avec. Nous sacrifions au rituel
du thé mongol, tentons quelques photos, mais les flashes sont mal
reçus.
Dans
la pénombre, malgré le poêle allumé, nous reconnaissons
Inke, aperçue seulement la première fois. Elle n’est pas seule.
Son mari, sa mère, ses enfants sont présents, revenus d’on
se sait où. Nous sommes déjà douze sous la tente de
trois mètres cinquante de diamètre. Nous nous installons difficilement.
Pas de recul pour la caméra, pas de lumière. Nous obtiendrons
péniblement quelques bougies. On fera avec. Nous sacrifions au rituel
du thé mongol, tentons quelques photos, mais les flashes sont mal
reçus.
Après quelques
cigarettes, Inke la chamane s’équipe avec l’aide de son mari. Elle
enfile une sorte de manteau composé de nombreuses bandes de tissu
de toutes couleurs, de bottes et d’un masque qui lui dissimule le visage.
Dressée devant un petit autel à notre gauche, elle nous tourne
presque le dos. Elle se saisi d’un grand tambour et d’une masse et commence
à marteler lentement le tambour. Elle entame en même temps une
lente mélopée, incompréhensible pour nous, et commence
une sorte de danse sur place. Au bout d’une demi heure, le rythme s’accélère.
Le martèlement du tambour se fait plus fort, plus présent ;
le piétinement se transforme en pirouettes saccadées, et le
tambour nous frôle et éteint les bougies si nécessaire
à Pierre-Marie recroquevillé dans la toile de la tente, et
qui tente de saisir le visage de la chamane dans la lueur vacillante des
bougies, que je tiens allumées avec peine. Au bout d’une heure, la
chamane tourne toujours et le tambour résonne avec une régularité
de métronome qui montre l’état hypnotique dans lequel elle se
trouve, sans lequel, frapper le tambour avec une telle force depuis si longtemps,
serait impossible. Son état de transe est maintenant
certain ; son mari s’est levé, et la cramponne fermement par la ceinture.
Sans se soutien, elle serait déjà tombée à plusieurs
reprise sur nous. Seul Tulga semble bizarrement étranger à la
scène.
Au bout d’une heure et demie bien comptée, la chamane, épuisée,
s’écroule doucement à terre, soutenue par son mari. Lentement,
il lui enlève son masque, son manteau, et elle revient parmi nous.
Encore un peu sous l’effet de sa communication avec les esprits, elle allume
une cigarette, répond à quelques questions où nous
apprenons qu’elle a communiqué pendant tout ce temps avec une centaine
d’esprits ! Et c’est fini. Pas congédiés, mais presque. Mais
cette fois, nous les avons les images. Des images rares d’une véritable
cérémonie, une véritable rencontre avec les esprits.
Le chamanisme n’est pas une religion, mais une croyance, une simple croyance.
Cette croyance est toujours bien présente aujourd’hui, même
si le régime passé, n’a pas, on peut le dire, favorisé
la persistance de ces croyances. Aujourd’hui, persistent un grand nombre
de règles liées à l’organisation de la ger, le foyer
étant le centre de la ger, elle-même un monde en réduction.
De nombreuses croyances sont liées à l’eau, comme ne pas uriner
dans l’eau, au feu : ne pas marcher sur les cendres. L’exemple le plus visible est l’oboo
(tas ou amas de pierres dans la traduction littérale). Oboo résidence des esprits, et
nous ne manquerons jamais, surtout nos guides, d’en faire le tour trois fois
et d’apporter notre pierre, ou offrande, à l’édifice. Le retour
au camp sera silencieux. Chacun s’interrogeant sur la véracité,
l’authenticité de ce que nous venons de voir. Ce qui est certain, c’est
le caractère unique de cette expérience qui n’est pas permise
à tout le monde, et qui restera gravée dans nos esprits.
L’exemple le plus visible est l’oboo
(tas ou amas de pierres dans la traduction littérale). Oboo résidence des esprits, et
nous ne manquerons jamais, surtout nos guides, d’en faire le tour trois fois
et d’apporter notre pierre, ou offrande, à l’édifice. Le retour
au camp sera silencieux. Chacun s’interrogeant sur la véracité,
l’authenticité de ce que nous venons de voir. Ce qui est certain, c’est
le caractère unique de cette expérience qui n’est pas permise
à tout le monde, et qui restera gravée dans nos esprits.
La partie de pêche du lendemain sera plus joyeuse, plus légère.
Nous avons loué un bateau, enfin, le petit bateau, trois mètres
cinquante. Si la pêche est évidemment dans toutes les têtes,
surtout Pierre-Marie et Bernard qui voudraient bien effacer, enfin, les
affronts successifs subis, une plongée au large, probablement la
dernière, est au programme de Dominique. Le propriétaire du
bateau est exact au rendez-vous. Neuf heures ; nous chargeons les bouteilles
pour la dernière fois et Pierre-Marie, Dominique, Tulga et moi-même
embarquons sur le petit bateau. En tout cas le moteur est bien refroidi,
il n’y a pas de capot. Il doit manquer des pièces je pense. Au niveau
du carburateur, rafistolé avec du fil de fer. Puis, le levier de marche
avant-arrière est bloqué … en marche avant, une chance. Bref,
si nous ne perdons pas l’hélice, nous devrions rentrer. A trois kilomètres
du rivage, Dominique part à l’eau pour trente à quarante minutes
maximum. De notre côté, nous mettons seulement les lignes à
l’eau. C’est au bout de trente minutes, alors que nous apercevons Dominique
remonter, que j’accroche une truite, une belle truite, elle doit faire soixante
centimètres. Je la remonte doucement, et elle arrive en surface en
même temps que Dominique à qui nous offrons sur un plateau,
quelques images à se mettre sous la dent. Puis, la truite sera relâchée
et regagnera les profondeurs du lac.
Pierre-Marie et Bernard n’aurons pas sorti un poisson de ce lac, et n’aurons
même pas eu une touche pour faire monter un peu d’adrénaline
! De toute façon, Bernard va échanger son matériel
de pêche, contre un filet pour la chasse aux papillons, ce ne saurait
être pire. Nous finissons la soirée au restaurant en pensant
au départ de Dominique demain. Malgré cela, la bonne humeur
circule, la vodka aussi.
Quatorze heures trente. Le convoi s’ébranle. Six personnes et sept
chevaux. Pierre-Marie, Bernard, Tulga, Olzii, le chef du camp qui a tenu
à nous accompagner, le propriétaire des chevaux et moi-même.
Le cheval supplémentaire est le cheval de bât. Le temps est
toujours exceptionnellement beau. Le soleil brille du matin au soir, même
si la température est parfois fraîche, car nous sommes sur un
plateau à plus de deux mille mètres d’altitude. Nous longeons
une fois de plus la rive gauche du lac. Au bout de deux heures, j’ai les fesses
brisées par la selle en bois. Mes compagnons ne sont pas mieux lotis,
mais vraiment je souffre. A la pause, je n’ose à peine descendre de
cheval. Les genoux bloqués, je m’écroule à terre. Vu
l’allure générale, le pas, je vais peut-être continuer
un peu à pied et tirer le cheval. Un peu reposés, nous repartons
pour bivouaquer encore près du lac. Cette fois par obligation, il faut
de l’eau pour les chevaux. Mais à peine repartis, j’entend un grand
bruit, et aperçois Pierre-Marie qui part devant nous au grand galop.
Enfin, quand le dis Pierre-Marie, c’est surtout son cheval. Je l’aperçois
brièvement qui galope au milieu des arbres, qui sème les sacs
; nous retrouverons même la selle arrachée par les branches.
Quelques secondes plus tard, je rejoins Pierre-Marie, à terre, désarçonné
par son cheval, qui, ont ne sait quelle mouche l’a piqué, s’est senti
un brusque désir d’indépendance. Fort heureusement Pierre-Marie,
hormis la frayeur, s’en sort sans une égratignure ; chute également
sans dommage pour la caméra dans le sac à dos. Néanmoins,
nous ne retrouverons pas le cheval, et notre guide partira deux heures, pour
ramener un autre animal et ainsi compenser le départ impromptu de la
monture de notre caméraman.
Le trajet de ce jour se terminera à dix-neuf heures trente, au bord
du lac comme prévu, dans un calme presque étouffant. Au loin,
un ciel noir annonciateur d’averse nous menace, mais nous serons épargnés.
A vingt heures quinze, le repas est sur le feu. Entre les projets du lendemain
et à venir, je pense à Dominique qui nous a quitté ce
matin. A l’aube, nous avons compris que la journée serait différente.
Nous ressentons le besoin de ne pas aller trop vite, pour ne pas connaître
ce moment trop tôt. Dominique a rangé ses affaires lentement,
tandis que nous préparions les nôtres pour une autre destination.
Nous nous regardons à peine, et il y a peu de choses à dire.
Nous connaissons tous ces moments pénibles où se séparent
des gens qui ont vécu des évènements particuliers,
des évènements qui créent des liens si forts. Lentement,
ses bagages sont chargés dans le camion. Dominique repart avec Onour
et Gamba, qui vont démarcher pour nous trouver un bateau pour dans
trois jours. Dominique repart avec le compresseur, les bouteilles, sa combinaison,
et tout ce matériel qui rend les transferts d’aérogares si
agréables ! Mais, ce soir, à la lueur dansante du feu de bois,
nous ressassons ce moment que tout le camp a voulu partager. Vers onze heures,
Olzii est venu nous convier à partager, une dernière fois,
la vodka mongole. Tout le monde est là. La bouteille tourne au-dessus
du plateau, les verres se remplissent ; nous sommes tous un peu émus.
Olzii remettra à chacun un petit cadeau. Qui un calepin, des timbres,
qui une broche du lac Khövsgöl… Mais ici, il n’y a pas de petit
cadeau. C’est le cadeau du cœur, celui qui n’a pas de prix. La dernière
poignée de main échangée, Dominique monte dans le camion
; un dernier signe de la main, c’est fini. Il ne reste qu’un nuage de poussière,
et des souvenirs.
C’est l’essentiel de mes pensées ce soir, dans le duvet. C’est probablement
l’essentiel de nos pensées à tous. Dans quarante-huit heures,
Dominique sera chez lui, à huit mille kilomètres. Il va retrouver
les nécessités et contraintes de la vie quotidienne moderne,
les pendules à respecter, le bruit, l’agitation. Mais sa vie ne sera
peut-être plus jamais la même qu’avant. Il n’oubliera pas. Un
jour nouveau arrive, un peu frais, mais le soleil s’est définitivement
incrusté dans notre paysage. Pourquoi s’en plaindre ? Pour compléter
les péripéties équestres de la veille, ce matin, nous
avons perdu un cheval qui a rongé sa longe pendant la nuit. Deux
longues heures de recherche son nécessaire pour le récupérer
après qu’il se soit, acculé au lac, jeté à l’eau.
Pas faciles les chevaux par ici. Le camp replié, nous nous engageons
cette fois perpendiculairement au lac, dans l’épaisse forêt,
vers un sommet le Kuren Uul, qui culmine à trois mille vingt mètres,
et qui fait l’objet d’une croyance particulière. Les uns derrières
les autres, nous nous enfonçons dans la forêt, où bizarrement,
règne un silence total. Hormis les pas des chevaux, les "tchoo tchoo"
sonores de leurs cavaliers, quelques bruits de branches brisées, pas
un souffle de vent, pas un chant d’oiseau.
Nous remontons ainsi pendant quelques heures, le lit d’un torrent asséché.
Vers quinze heures, nous n’avançons plus guère, le terrain
est maintenant trop accidenté pour nos montures. Nous mettons pied
à terre. "C’est trop dur pour les chevaux, fait Pierre-Marie, nous
n’avançons plus"
-D’accord fais-je, restons-en là avec les chevaux. Bernard approuve
:
-"Il est déjà quinze heures, si nous voulons accéder
au sommet, chargeons un petit sac et finissons à pied."
Joignant le geste à la parole, les chevaux sont dessellés,
entravés, et vont rester sous la surveillance du guide.
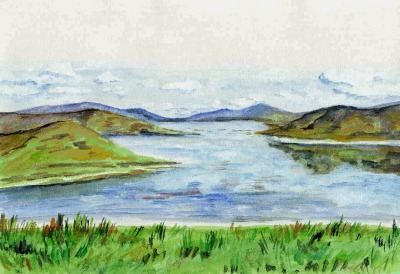 Le
chemin, si l’on peut dire, car il n’y a pas la moindre trace, semble facile
à déchiffrer. Nous continuons avec Tulga et Olzii à
monter le long du torrent à sec. Après une longue montée,
les sapins disparaissent et nous continuons dans de gros éboulis,
pour après deux heures trente de marche, atteindre le sommet. Un vent
glacial nous attrape sur un sommet presque plat, où ne règne
que le minéral. Les gens, paysans, guides, les jeunes qui ont bien
voulu répondre à nos questions ont été unanimes
pour dire que l’eau est l’Elément important de la vie quotidienne
et de la Vie en général en Mongolie. L’eau est et restera encore
longtemps le centre des préoccupations de la population Mongole. Du
fond du lac vient l’origine de la vie ; à tel point qu’un paysan interrogé
quelques jours auparavant imaginait un lac à la place du sommet pelé
du Kuren Uul. Il habite pourtant à côté, mais n’est
jamais monté. Monter ? Mais pourquoi faire ?
Le
chemin, si l’on peut dire, car il n’y a pas la moindre trace, semble facile
à déchiffrer. Nous continuons avec Tulga et Olzii à
monter le long du torrent à sec. Après une longue montée,
les sapins disparaissent et nous continuons dans de gros éboulis,
pour après deux heures trente de marche, atteindre le sommet. Un vent
glacial nous attrape sur un sommet presque plat, où ne règne
que le minéral. Les gens, paysans, guides, les jeunes qui ont bien
voulu répondre à nos questions ont été unanimes
pour dire que l’eau est l’Elément important de la vie quotidienne
et de la Vie en général en Mongolie. L’eau est et restera encore
longtemps le centre des préoccupations de la population Mongole. Du
fond du lac vient l’origine de la vie ; à tel point qu’un paysan interrogé
quelques jours auparavant imaginait un lac à la place du sommet pelé
du Kuren Uul. Il habite pourtant à côté, mais n’est
jamais monté. Monter ? Mais pourquoi faire ?
Nous ne voyons, du sommet, toutes ces rivières qui se jettent dans
le lac. Par contre, en regardant vers le sud, nous apercevons Khatgal, et
Khatgal est à l’embouchure du lac, à l’entrée de la
seule rivière qui s’en échappe, la rivière Egin Gol,
la rivière sacrée. Rivière qui elle-même se jette
dans la rivière Selenge, qui alimentera le lac Baïkal. Mais à
dix-sept heures trente, il est temps de redescendre. Nous nous perdrons,
un peu, lors de cette descente, où nous ne savons exactement quelle
brèche, quel goulet nous avons utilisé à la montée.
Mais nous retrouverons le guide des chevaux vers dix-neuf heures trente.
Après une rapide collation, nous enfourchons nos montures et reprenons
le chemin, pour, de nuit, arriver à nouveau au lac, qui permettra
à nouveau aux chevaux de s’abreuver. Fourbus, rompus mais heureux,
c’est café et thé mongol devant le feu. En regardant les étoiles,
nous prenons vraiment conscience de toute cette beauté, de tout ce
calme, et nous imaginons Dominique confronté à nouveau avec
la vie dite civilisée, avec un détachement et une satisfaction
presque honteux.
Lundi 10 septembre
Quand nous réintégrons le camp vers seize heures, Gamba
et Onour nous attendent. Je ne sais si nous avons une passagère supplémentaire,
mais une chèvre est attachée à un piquet près
des gers. Cela ne nous soucie guère, et pourtant !
Après un filet de douche, nous nous sentons des hommes neufs ; neufs
mais encore fatigués. Une petite sieste s’impose après ces
trois jours, et nous retrouvons vers dix-neuf heures, ce restaurant où
nous avons maintenant nos habitudes. Mais ce soir est un jour spécial,
Gamba a quarante ans, et tient à nous faire partager ce moment. Il
nous invite à nous reposer après le repas, et nous préviendra
pour le dessert, qu’il se charge de préparer. Vers vingt-trois heures,
Tulga sonne le rappel. Pas très motivée l’équipe ;
et si un énorme feu nous attend prés du lac, nous louchons
quand même vers nos duvets avec envie. Mais la petite salle est à
nouveau en effervescence. Eclairée à la bougie, il y règne
une douce ambiance, et nous nous installons tous à nouveau, autour
de Gamba qui tient lui-même à nous faire les honneurs de son
dessert.
Il arrive dans un bidon à lait de vingt litres. Est-ce un dessert
liquide ? Point ! Le bidon ouvert, nous allons faire mieux connaissance avec
la chèvre attachée au piquet dans l’après-midi, car
le dessert, c’est elle ! Préparée comme la marmotte. Sauf que
c’est difficile à remplir une chèvre, alors la manœuvre est
un peu différente. La chèvre est découpée, placée
dans le bidon avec les légumes et les pierres brûlantes, et
pour bien mélanger le tout, on roule le bidon par terre. Le résultat
est parfaitement identique. Mais comme dessert, j’en connais deux qui auraient
préféré tartes aux fraises, gâteau au chocolat
et crème anglaise, mais, c’est chèvre bouillie, et il va falloir
y passer, n’est ce pas les gars ? La dégustation se déroule
malgré tout fort bien. Enfin mieux pour certains, que pour d’autres.
Mais cette soirée à quand même quelque chose de magique.
Pour honorer Gamba, chacun est tenu d’y aller de sa petite chanson. Et si
les chants mongols sont restés parfaitement incompréhensibles
pour nous, leur tonalité a mis une touche de grande douceur et de
solennité à cette soirée. La vodka sera aussi à
l’honneur et même le vin mousseux, ici, si loin ; si loin.
Mardi 11 septembre
Il a bien gelé cette nuit. Nous allons quitter Olzii, Ondrakh et
les autres. A midi, l’émotion est à son comble, et la vodka,
décidément, est à nouveau de la partie. Mais, en fait
rien de plus que les habitudes européennes. La piste jusqu’à
Khatgal est dure. Mais c’est à Khatgal que nous attend le canot pneumatique
qui doit nous permettre de descendre la rivière sacrée Egin
Gol. La négociation pour le canot se passe de l’autre côté
du lac, et Gamba semble avoir beaucoup de difficulté à négocier
tarif et condition pour ce canot de trois mètres soixante, et qui
nous paraît bien petit. Néanmoins, à prix d’or, le canot
nous sera livré le lendemain à neuf heures au campement que
nous allons à nouveau installer près de la falaise aux taimens,
emplacement déjà utilisé le deux septembre. Mais aujourd’hui,
depuis Khatgal, nous avons repris la route dans l’autre sens, vers Oulan-Bator.
Les cannes sont à nouveau sorties et j’attrape rapidement une truite
de cinquante centimètres qui fera notre repas de ce soir avec du riz.
Nous ne savons encore rien des "évènements".
Nuit agitée, pluvieuse et même orageuse. L’été
indien si on peut l’appeler ainsi, semble nous quitter lentement. Les couleurs
de l’automne se révèlent maintenant avec plus de force. Bientôt
le pays retournera à son isolement glacé et à une sorte
d’oubli. Le pays nous pousse, encore gentiment, dehors.
Neuf heures, le canot est livré avec une ponctualité remarquable.
Il me semble encore plus petit que la veille. Je me souviens du chargement
des kayaks au Spitzberg, et trouve d’étranges similitudes avec la
situation du moment. Nous espérons qu’il n’y aura pas de problème
sur cette rivière, que nous ne connaissons absolument pas. Pourquoi
? Si nous avons un gonfleur, pas de colle, pas un bout de tissu, de caoutchouc
pour réparer. Merveilleux ! Et avec les deux minuscules pagaies en
plastique souple, si il y a des rapides, quelques rouleaux, il va y avoir
du sport !
Quand il faut y aller, il faut y aller ; Inutile de cauchemarder sur un
prochain et probable naufrage. Nous embarquons vers onze heures, sur une
rivière à peine agitée, mais au niveau si bas, qu’il
faut souvent descendre pour soulager le canot. A nouveau dans le fil du
courant, une première et fine averse nous mouille pendant une petite
heure. La première depuis dix-sept jours. La piste permet au camion
de nous suivre pendant quelques heures le long de l’Egin-Gol, et surveiller
que nous ne soyons déjà perdus corps et bien.
L’averse passée, c’est un nouvel arrêt pêche vers quatorze
heures trente, à nouveau sous un soleil brûlant. Un désastre
de plus. Nous accostons après avoir parcouru une vingtaine des soixante
kilomètres prévus jusqu’au rendez-vous avec le camion le quinze
septembre. La piste s’éloigne maintenant, et le camion avec. Nous
sommes totalement seuls jusqu’au quinze septembre au soir, si tout va bien.
Le vent s’est levé ce soir, alors que Tulga prépare truite
et riz. Pendant ce temps, Bernard et Pierre-Marie rêvent de taimens,
taimens encore virtuels pour employer un nouveau langage. Aujourd’hui, la
rivière nous a servi des couleurs magiques, mélange de l’orage
qui nous suit de près, et des ors de l’automne comme il en existe
si peu au monde. Vers vingt heures trente, Pierre-Marie prendra une autre
truite ; -"Allez Pierre-Marie, fais-je mi goguenard, mi moqueur, cette fois
l’honneur est vraiment sauf !
-Merci Philippe, mais là, toutes mes certitudes viennent de tomber.
-quand à moi, fait Bernard absolument consterné par ses performances,
je cultive depuis le départ, une certaine incompatibilité avec
l’eau et les poissons. Vivement que je rentre pour retrouver mes repères.
Nous sommes tous d’accord. Le ciel est entièrement couvert
ce matin, quand nous mettons le canot à l’eau. Si quelques essais
pêche se révèlent à nouveau un épouvantable
fiasco, la rencontre de ce jour, à été inversement proportionnelle.
Le ciel est entièrement couvert
ce matin, quand nous mettons le canot à l’eau. Si quelques essais
pêche se révèlent à nouveau un épouvantable
fiasco, la rencontre de ce jour, à été inversement proportionnelle.
C’est au milieu de l’après-midi du treize septembre, au soleil à
nouveau revenu, que nous apercevons deux gers à trois cent mètres
de la rive. Après avoir accosté, Tulga part en éclaireur
pour nous introduire auprès des habitants des lieux. A priori, pas
de difficulté. Nous remontons vers le petit replat qui mène
à la ger, et sommes invités à entrer. Un couple, des
enfants et petits-enfants, surpris de notre équipage ; il est vrai
que ce mode de déplacement est peu courant. En dehors de leurs dispositions
tout-à-fait naturelles à accueillir les voyageurs, la curiosité
n’est pas feinte. Les distractions sont rares par ici. Nous entrons en respectant
les règles naturelles de bienséance qui régissent la
vie quotidienne des mongols. Sans heurter, ni s’arrêter sur le seuil,
nous nous dirigeons vers la gauche où nous nous installons soit sur
les sièges mis à notre disposition, ou par terre. Un round d’observation
commence. Nous somme aussi intimidés qu’eux, alors que nous connaissons
tous notre envie d’échanger. Ces quelques minutes, me permettent de
constater l’immuable disposition des lieux. La porte, toujours au sud, le
petit autel dans le fond. Posé dessus, un miroir, de photos de famille
parfois un peu jaunie ; de chaque côté des meubles joliment
peints, et le fourneau au centre. Cette famille dispose de quelques richesses,
dont un tracteur et une remorque, moderne, avec des roues, et des pneus en
caoutchouc! La femme se lève, remplis un bol, et nous sacrifions,
par trois fois au thé mongol. Un petit goût acide, sûr,
malgré tout rien à voir avec l’airak. Puis, nous sommes invités
à déjeuner. Quatre assiettes fumantes sont déposées
devant nous ; et sans réserve, nous dégustons ce délicieux
plat mongol à base de pâtes et boulettes de viande. Quelques
mots s’échangent avec nos nouveaux amis grâce à Tulga
; l’atmosphère se détend, naturellement. Les enfants jouent
par terre avec la mappemonde en plastique gonflée par Bernard. Nous
nous rapprochons, pour montrer la France et la Mongolie Pour honorer les
visiteurs, tout le monde a sorti les habits du dimanche. Dels pour les adultes,
vêtements nouveaux pour les enfants à qui on a brossé
les cheveux, posé de jolies barrettes. La coquetterie s’exerce jusqu’ici
! Des visiteurs, c’est un peu la fête, un peu dimanche. Et dans cette
ger, il y a même un poste de radio. Il est allumé, et nos amis
semblent perplexes devant les paroles qui en sortent. Par nos guides, nous
apprenons qu’il y aurait de grandes manifestations aux Etats-Unis, mais
sans comprendre la réalité, et l’extrême gravité
du message. Mais le temps passe si vite ; vers 22 heures, je vais rejoindre
le duvet, pendant que Bernard et Pierre-Marie, vont expérimenter
les techniques de pêche locales, techniques qui vont bouleverser à
tout jamais leurs théories. Bon j’exagère un peu, mais nous
retournons à des méthodes de pêche absolument préhistoriques
!
Imaginez une espèce de coupelle métallique au bout d’une perche
de deux mètres ; dans ce réceptacle, on dépose tout
ce qui peut brûler, en l’occurrence du caoutchouc. Enflammé
et tenu à bout de bras au dessus de la rivière, elle permet
à un second comparse de scruter l’eau avec une seconde perche, munie,
elle, d’un trident métallique sommaire, mais à l’efficacité
redoutable. Il faut être vraiment entraîné, pour apercevoir
les poissons entre le courant, les reflets de l’eau et du brûlot ;
et en plus ça marche ! Devant mes compagnons effarés, les poissons
adroitement piqués sortent rapidement de l’eau. Bredouilles, apparemment,
les autochtones de connaissent pas. Quand, le lendemain, nous les inviterons
à essayer notre matériel, il trouveront tout ça bien
compliqué, pour un bien piètre résultat. Néanmoins,
ils nous inviterons à partager un nouveau repas de thé, mouton
bouilli, pommes de terre et oignons sauvages. La viande est excellente. Ici,
pas d’ESB, de farines animales, pas de problèmes de nitrates ; ici
rien que du naturel, et tout le monde s’en porte fort bien. Vers treize heures,
nous devons remballer le camp, et continuer la descente de cette rivière,
à la recherche du taimen. Notre départ est un peu triste, voir
presque pathétique sous la pluie, dans notre minuscule canot. Mais
un départ, c’est toujours vers autre chose, vers d’autres surprises,
d’autres rencontres. Il aura suffit de quelques mots, quelques regards, pour
que cet instant passé loin de tout, au milieu de la steppe, reste gravé
à tout jamais. Nos chances, avec les kilomètres qui défilent,
se réduisent comme peau de chagrin. Ce poisson mythique restera pour
mes amis, je le crains, un pur fantasme. Les bons coins à taimens,
indiqués lors de rencontres impromptues au bord de la rivière,
se révèlent tous déserts.
L’hiver approche ; le vent froid et la pluie se font plus durement sentir.
Dans l’après-midi, un pont en bois, nous oblige à accoster.
Aussitôt, une douzaine de gamins dépenaillés nous rejoignent
et font cercle autour de nous. Le canot est déchargé, et,
en quelques voyages, matériel et canot sont de l’autre côté
du pont. A nouveau, avec acharnement, les cannes sont à nouveau en
service. Bernard, rapidement dégoûté remballe au bout
d’une demi heure. Il fait froid, humide et nous contemplons la demi-douzaine
de gamins en haillons. Décidément, la grande taille de Bernard
surprend et intrigue. Pendant que Pierre-Marie trempe du fil avec l’énergie
du désespoir, nous jouons avec les gamins, jusqu’au moment où
remontant les bas de pantalons, nous les voyons hurler de rire devant notre
poil aux jambes, alors que ces populations sont connues pour être
particulièrement imberbes. Et au moment où ils se tordent
de rire, devant nos velus mollets, que nous entendons également hurler
Pierre-Marie. En fait, il est assez loin de nous, environ quatre-vingt mètres,
et de l’autre côté de la rive. Continuant à vociférer
bruyamment, nous comprenons rapidement la situation. Un poisson, quel poisson,
nous n’en savons rien, mais un gros assurément. Nous courons tous
vers lui. Arrivés, nous constatons que son opiniâtreté
à mouiller du fil, vient de payer. Un taimen, un vrai, est au bord
de l’eau. Ce mythique poisson, objet de tous les désirs depuis la
France même, de toutes les convoitises, plus attendus que le Père
Noël, que la remontée du Dow Jones, plus désiré
qu’une nuit avec Sharon Stone, le taimen est entre les mains de Pierre-Marie.
Pas énorme, un mètre, une douzaine de kilos. Mais c’est le
poisson qui affole le cœur, et ravale le saumon King au rang de simple sardine.
Le contrat taimen est rempli, et il nous restait très peu de temps.
La pluie cessant vers dix-neuf heures trente, nous réembarquons avec
le fameux poisson entre les pieds. Onour et Gamba nous attendent maintenant
un peu plus bas.
La nuit est là, quand nous abordons sur une belle prairie, après
un petit défilé, avec, en face, une belle falaise couverte
d’une forêt aux couleurs qui augurent d’un hiver proche. A la lumière
des lampes frontales, le camp est monté, le taimen est découpé
en tranche, les pâtes cuisent, et la bouteille de vin blanc que nous
promenons depuis le départ avec l’objectif de ne l’ouvrir que pour
un taimen, trône devant nous. Il est vingt-deux heures trente, et c’est
la fête devant les énormes tranches de poisson.
Samedi 15 septembre.
Treize heures trente ; Nous montons dans le canot pour la dernière
fois, par un temps frais mais beau à nouveau. Dans quelques kilomètres,
nous allons faire la jonction avec le camion, Gamba et Onour, et ce merveilleux
voyage sera, presque, terminé. Non seulement il sera terminé,
mais c’est en fait pire que ça. C’est quelque chose qui se casse
en nous, comme une douleur qui n’a pas de remède, une impuissance
à empêcher la fuite du temps.
Toutes les phases de cette opération, comme au Spitzberg, sont couronnées
de succès. Depuis le départ, tout nous a sourit avec une chance
absolument insolente ; A commencer par la météo. A part pendant
quarante-huit heures, il a fait imperturbablement beau. Que ce soit les
six jours pour accéder au Khövsgöl ou les plongées.
Dame nature nous a également autorisé l’accès au sommet
du Küren Uül, 3026 mètres. L’année précédente,
un mètre de neige, à la même époque, avait anéanti
les espoirs d’accès au sommet d’un groupe de touriste. La truite et
le taimen ont été attrapés, le thème de l’eau,
les croyances autour de l’eau ont été largement exploitées,
la cérémonie chamane est, non pas la cerise sur le gâteau,
mais le bon gros kilo de cerises pour bien recouvrir tout le gâteau.
Oh, il y aura encore quelques péripéties avant de rentrer
à Oulan-Bator, mais rien de bien sérieux. Bien sûr,
les pompes à essence seront parfois vides sur notre route. Sept cent
kilomètres avec vingt litres, c’est dur. Gamba nous aura quitté,
pour organiser notre retour dans la capitale, notre hébergement,
et surtout, surtout devra organiser notre passage à l’aéroport,
car nous sommes, légèrement en surcharge avec les bagages.
La routine. Nous profiterons de notre retour à Khatgal et rendre le
canot, pour utiliser les installations sanitaires de l’hôtel. "Blue
Pearl". Un petit hôtel désuet, modeste, de trois ou quatre chambres,
aux allures de far west, mais une petite douche, que rêver de mieux.
Nous commandons la douche, en même temps qu’un repas. A cette saison,
il n’y a personne. Un peu de visite, un peu de commerce, c’est aussi un
peu d’animation. Nous flânons tranquillement, au soleil, sur la terrasse,
assis sur les bancs, accoudés aux tables quand on nous annonce que
la douche est prête. Heureusement que nous ne sommes pas nombreux,
car c’est chacun son tour. Quand arrive mon tour, je comprends le sourire
en coin de mes amis qui, eux, en sortent. Je suis invité à
pénétrer dans l’hôtel par un long et large couloir où
les fils électriques parcourent le plafond dans le plus grande fantaisie.
Je tourne à gauche dans une grande pièce carrelée où
se trouvent deux douches, aux planches mal jointes, montant jusqu’à
un mètre quatre-vingt du sol. Ici, c’est suffisant. Bernard pouvait
ainsi se laver et surveiller les alentours ! Mais au moins, ce sont de grandes
douches, deux mètres sur deux. Au sol, un petit caillebotis de trente
centimètres de côté. En levant les yeux, j’aperçois
différents tuyaux qui courent au-dessus de ma tête, dont un,
qui a déclaré un incendie dans le plafond. Un jeune garçon
m’explique comment ouvrir et fermer l’eau avec une pince, puisqu’il n’y
a pas de robinet. Puis il sort, avec la pince, ne me laissant que les dents
pour manœuvrer le bout de métal. Déshabillé, je m’aventure
précautionneusement sous la pomme de douche, me demandant ce qui allait
en sortir. Oh miracle ! C’est de l’eau, chaude. Un filet d’eau, je dirai
comme d’habitude, mais ininterrompu et ma fois fort agréable. Je dois
simplement faire attention à la tige métallique de trente centimètre
qui sort du mur à hauteur de mes yeux.
Tout le monde passé à la douche, c’est Bernard qui régale
au restaurant. Les "boozes" sont à nouveau excellentes, et nous honorons
ce repas qui nous coûtera pour six personnes, sept mille togrits, ou
sept dollars, ou cinquante francs. C’est à Möron, que nous comprendrons
le sens exact du message radio entendu quelques jours plus tôt, quand
nos amis parlaient de grandes manifestations aux Etats-Unis. Un touriste fraîchement débarqué,
nous annonce la réalité des évènements survenus
le onze septembre, nouvelle qui nous laisse pétrifiés. A quelques
jours de notre embarquement, nous ne savons, d’une part, quelle attitude adopter,
et ensuite quelles répercussions ces dramatiques nouvelles, vont avoir
sur notre retour, si retour n’est pas un mot à éviter. Nous
reprendrons quand même la piste vers Oulan-Bator, que nous atteindrons
sans encombre, trois jours plus tard, après de nouvelles rencontres,
après avoir croisé un loup sur la piste.
Nous sentons un net regain des températures, les montagnes, le lac
Khövsgöl, inke la chamane, Olzii le gardien du camp et tous nos
amis, sont maintenant bien loin. Il fait encore beau et frais, tellement
que je crois le temps arrêté. Ce n’est pas le cas. Nous allons
encore, aujourd’hui, nous remplir les yeux de ces collines, de ces immenses
étendues, où dans chaque tache blanche, la vie est présente,
et suis son cours, immuable, depuis des millénaires.
Ce soir, nous serons à Oulan-Bator. Car nous devions établir
notre dernier campement à quelques kilomètres de la capitale.
Mais Tulga a une autre idée. Il souhaite nous inviter chez ses parents,
nous présenter sa famille. Sauf que nous ressemblons à des
hommes… des bois. Mais son insistance a raison de nos réticences.
 Et nous
nous retrouvons, en ville à nouveau, pour quelques heures qui vous
nous paraître bien courtes. A l’approche de la banlieue, le bitume
disparaît pour la terre battue. La maison des parents de Tulga est une
maison récente, moderne, mais sans eau courante dans la salle de bain,
et aux toilettes au fond du jardin. Malgré ces menus détails,
nous sommes parfaitement reçus, et l’étage nous est alloué
pour ranger notre matériel et passer la nuit dans nos duvets, sur les
tapis, dans une pièce carrée, en dur. Comment ne pas regretter
la tente, que l’on ouvre le matin, sur l’infini. Je me souviens d’herbe qui
ondule jusqu’à l’horizon, comme à l’aube du monde. Je me souviens de l’eau qui chauffe
avec son panache de vapeur dans le matin frais, le thé brûlant
que l’on boit à petites gorgées, en pensant à l’inconnu
et au mystère de la journée qui s’ouvre à nous. Comment
ne pas être bouleversé par la magie qui se dégage de cet
immense pays, par la beauté des paysages et plus encore par la volonté
de ce peuple de perpétuer des traditions millénaires.
Cet étrange
voyage se termine devant le bouddha géant du temple de Janraïseg
du monastère de Gandan. Ce gigantesque bouddha de plus de vingt-cinq
mètres de haut, a été détruit par la Russie dans
les années 1930. Malgré tout, il a été reconstruit,
et la vie suit son cours au monastère de Gandan, et les activités
religieuses ont repris. De nombreux temples se dressent encore
autour de ce site mythique. Si celui-ci a été édifié
pour célébrer la fin de la domination mandchoue , d’autres
monuments témoignent de l’histoire, mouvementée de la Mongolie,
mais il en est hélas ainsi, partout dans le monde. C’est l’image des éleveurs, de
leur hospitalité, de leur ouverture, de leur profond respect pour autrui,
pour la nature, qui restera le plus profondément marquée.
Et nous
nous retrouvons, en ville à nouveau, pour quelques heures qui vous
nous paraître bien courtes. A l’approche de la banlieue, le bitume
disparaît pour la terre battue. La maison des parents de Tulga est une
maison récente, moderne, mais sans eau courante dans la salle de bain,
et aux toilettes au fond du jardin. Malgré ces menus détails,
nous sommes parfaitement reçus, et l’étage nous est alloué
pour ranger notre matériel et passer la nuit dans nos duvets, sur les
tapis, dans une pièce carrée, en dur. Comment ne pas regretter
la tente, que l’on ouvre le matin, sur l’infini. Je me souviens d’herbe qui
ondule jusqu’à l’horizon, comme à l’aube du monde. Je me souviens de l’eau qui chauffe
avec son panache de vapeur dans le matin frais, le thé brûlant
que l’on boit à petites gorgées, en pensant à l’inconnu
et au mystère de la journée qui s’ouvre à nous. Comment
ne pas être bouleversé par la magie qui se dégage de cet
immense pays, par la beauté des paysages et plus encore par la volonté
de ce peuple de perpétuer des traditions millénaires.
Cet étrange
voyage se termine devant le bouddha géant du temple de Janraïseg
du monastère de Gandan. Ce gigantesque bouddha de plus de vingt-cinq
mètres de haut, a été détruit par la Russie dans
les années 1930. Malgré tout, il a été reconstruit,
et la vie suit son cours au monastère de Gandan, et les activités
religieuses ont repris. De nombreux temples se dressent encore
autour de ce site mythique. Si celui-ci a été édifié
pour célébrer la fin de la domination mandchoue , d’autres
monuments témoignent de l’histoire, mouvementée de la Mongolie,
mais il en est hélas ainsi, partout dans le monde. C’est l’image des éleveurs, de
leur hospitalité, de leur ouverture, de leur profond respect pour autrui,
pour la nature, qui restera le plus profondément marquée.
Un voyage entre le moyen-âge et la préhistoire, presque intemporel,
qui une fois de plus, une fois rentré, me paraîtra presque
irréel. Il y a quelques mois, nous parcourions, plaines et montagnes
lacs et rivières, à pied, à cheval, en canot ; sur
l’eau et sous l’eau, l’eau sacrée des Mongols.
|